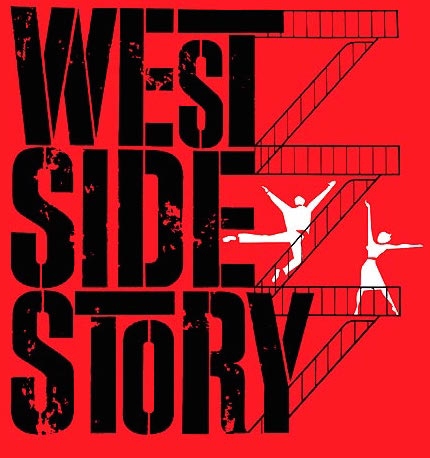 J’attendais ce moment avec une immense impatience. West Side Story à Paris.
J’attendais ce moment avec une immense impatience. West Side Story à Paris.
En 2012 je l’avais loupé au Théâtre du Châtelet, je m’étais consolée avec les merveilleux « The King and I » et « Un Américain à Paris » en 2014, puis par le somptueux « Singin’in the rain » l’année suivante, toujours sous la très judicieuse direction artistique de Jean-Luc Choplin.
Ce soir là, nous nous rendons à La Seine Musicale en famille, les rôles ont été si bien répétés que enfants, parents et grand-mère sont prêts à remplacer au pied levé un danseur blessé ou un chanteur enroué ![]() . C’est donc en chantant, et en improvisant quelques pas de danse, que nous découvrons cette nouvelle salle. Nous nous installons à 15 kilomètres de la scène sur les « gradins », alors que nous avons acheté nos places en 1ère catégorie (105 € la place tout de même). Avant de connaître la configuration de la grande salle de La Seine Musicale, je pensais que l’usage des jumelles était réservé aux enfants du Paradis, première erreur. Les yeux écarquillés, comme pour regarder une diapositive sur une table lumineuse disproportionnée, le rideau s’ouvre, pas tout à fait d’ailleurs, les girafes et les éléphants, et autres bestiaux célestes, de l’étrange rideau de scène de Nicolas Buffe, continuent à nous observer.
. C’est donc en chantant, et en improvisant quelques pas de danse, que nous découvrons cette nouvelle salle. Nous nous installons à 15 kilomètres de la scène sur les « gradins », alors que nous avons acheté nos places en 1ère catégorie (105 € la place tout de même). Avant de connaître la configuration de la grande salle de La Seine Musicale, je pensais que l’usage des jumelles était réservé aux enfants du Paradis, première erreur. Les yeux écarquillés, comme pour regarder une diapositive sur une table lumineuse disproportionnée, le rideau s’ouvre, pas tout à fait d’ailleurs, les girafes et les éléphants, et autres bestiaux célestes, de l’étrange rideau de scène de Nicolas Buffe, continuent à nous observer.
L’Orchestre dirigé par un spécialiste du genre, et de ce chef-d’oeuvre en particulier, a beaucoup de peine à suivre la partition de Bernstein. La modernité indiscutable et l’énergie fantastique du compositeur Leonard Bernstein, Maestro spécialiste de Stravinski, se trouve engoncée dans d’hasardeux arrangements. La sonorisation s’égare, elle accentue les envolées lyriques d’une façon quelque peu outrancière, le passage dans les micros se fait sentir lors du glissement des curseurs sur la table de mixage au plus haut, le souhait est de faire frissonner le public… Sans nuance et effectuant des dérapages incontrôlés, Tony écrase sa voix, il semble avoir la voix fatiguée et a certainement oublié de protéger ses cordes vocales du froid parisien. La jolie Maria a le mérite inouï de conserver sa justesse auprès de son partenaire, elle a la voix belle mais l’intention demeure terne. L’intrépide Anita relève le défi mais c’est déjà trop tard, le mal est fait.
La mise en scène est menée tambour battant. Le metteur en scène, qui a été élève et assistant de Jerome Robbins, a depuis dirigé plusieurs ballets de comédies musicales, il est le seul à chorégraphier cette unique production de West Side Story, en tournée dans le monde entier, et validée dit-on par Robbins Rights Trust, dont acte. Pourtant Robbins n’est pas là. Jerome Robbins a inscrit la danse américaine dans une forme de théâtralité, l’amour et le désir sont aériens, l’espoir se danse comme il se chante, et l’action s’exprime par un mouvement virtuose, d’une fluidité poétique, qui doit se lire aussi dans les scènes de bagarres… Ce soir là, ce n’est pas le cas. La joie de la danse mêlée à l’humour se font sentir mais la rapidité jazzy et surtout la précision raffinée du geste semblent avoir été oubliées au profit de l’exploit.
Pour ses soixante ans, West Side Story à La Seine Musicale prend l’allure d’un spectacle de Music Hall kitch alors qu’il s’agit d’un chef d’œuvre intemporel et d’une modernité absolue autant que peut l’être L’Opéra de Quat’Sous de Brecht et Weill créé trente ans plus tôt. Les costumes et lumières à la tonalité magenta essaient peut-être de faire oublier qu’il s’agit de la première œuvre musicale inspirée d’un drame Shakespearien inscrit dans l’actualité sociale de l’époque avec ses guerres des gangs qui ravagent le New-York des années 50. Dix ans avant la comédie rock ‘Hair’, le théâtre musical américain a été profondément révolutionné lors de la création de West Side Story en 1957 alors que les premiers producteurs craignaient l’histoire trop sombre et la partition trop élitiste pour un spectacle populaire.
Bref, l’émotion se disloque au quatre coins du bien trop vaste plateau de La Seine Musicale. La sauce ne prend pas, jusqu’à la scène finale quand Maria tente de relever Tony pour fredonner un dernier « There’s a place for us… », un moment sensé faire fondre les plus froids d’entre nous : c’est raté.
Quand West Side Story s’est jouée au Châtelet, en 1981 j’avais dix ans, puis en 1991 j’avais vingt ans, j’étais dans la salle à chaque fois : c’était dingue ! En 2017, le spectacle se clôt sous des applaudissements sans rappel. Pas de standing ovation. Impossible à croire. Maintenant, je suis convaincue : ce n‘était pas West Side Story, c’était autre chose. Dimanche soir, nous regarderons à nouveau le film de Robert Wise, en famille, au moins je suis certaine que le sens critique de mes enfants aura été attisé !
Laurence Caron
